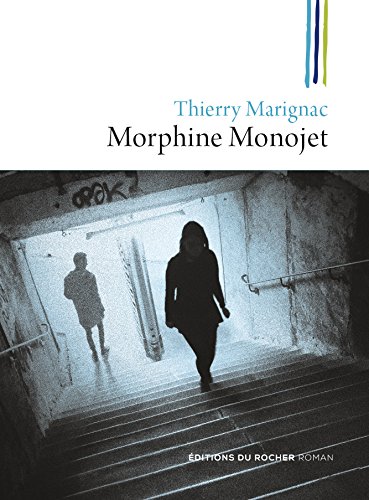| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
norbert
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 48
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 12137
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le: Dim Jan 31, 2016 3:35 pm Sujet du message: Morphine Monojet - Thierry Marignac (Editions du Rocher) Posté le: Dim Jan 31, 2016 3:35 pm Sujet du message: Morphine Monojet - Thierry Marignac (Editions du Rocher) |
 |
|
Après la réédition de son premier roman Fasciste l'été dernier, Thierry Marignac nous revient enfin avec un nouveau roman, Morphine Monojet (ou Les Fils perdus), qui vient de paraître aux Editions du Rocher.
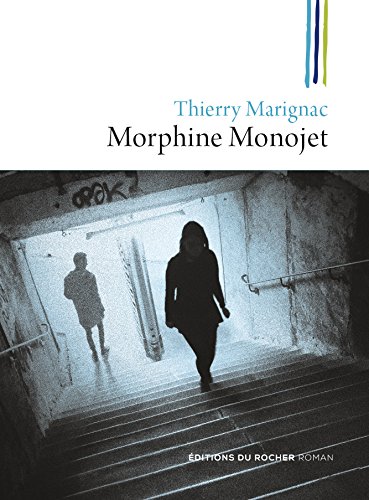
Le livre :
Lorsque Al, camé impénitent à la fiabilité incertaine, dérobe un Morphine Monojet - seringue de morphine pour les soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale - dans un sous-sol chez la belle Jackie, Orientale mélancolique, où les aléas du manque l'ont poussé lui et ses deux compagnons, Fernand et le fils perdu, il les lance du même coup à sa poursuite, bientôt effrénée, dans le Paris charnière de 1979, en proie aux reconstructions qui en feront une ville du XXIe siècle.
Al vivra-t-il la meilleure défonce de sa vie ?
« Thierry Marignac fait partie d’une très vieille tribu littéraire, celle des écrivains dont Octave Mirbeau disait qu’ils se réveillent en colère et se couchent furieux. » Jérôme Leroy
>> Le blog de l'auteur : http://antifixion.blogspot.fr/
L'auteur :
Auteur d'un premier roman devenu culte, Fasciste, Thierry Marignac a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels Fuyards, À quai (Rivages/noir), Renegade Boxing Club (Série Noire) et dernièrement Milieu hostile (Baleine).
Il a également publié un essai remarqué sur Norman Mailer.
Il publiera le 23 février Cargo sobre - Chronique intime d’une traversée de l’Atlantique en porte-conteneurs (Editions Vagabonde), journal de voyage rédigé au cours d’une traversée entre Fos-sur-Mer et New York sur un porte-conteneurs d’une compagnie maritime de fret.
_________________
« Il vaut mieux cinq mille lecteurs qui ne vous oublieront plus jamais à des centaines de milliers qui vous auront consommé comme une denrée périssable. » Jérôme Leroy
Dernière édition par norbert le Ven Fév 26, 2016 6:33 am; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
norbert
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 48
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 12137
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le: Lun Fév 01, 2016 9:04 pm Sujet du message: Posté le: Lun Fév 01, 2016 9:04 pm Sujet du message: |
 |
|
>> La chronique [ infiltrée par Thierry Marignac... ] de Velda sur son Blog du Polar :
| Citation: |
Thierry Marignac, Morphine Monojet : Le retour du fils perdu ?
Depuis Milieu hostile (voir ici), paru en 2011, silence radio côté Thierry Marignac.
En juin 2015, un signe : l’heureuse réédition par ActuSF de son premier roman, Fasciste (voir là la chronique et ici l'interview).
C’est dire si ce début d’année 2016 va réjouir les inconditionnels et, espérons-le, ravir les lecteurs qui n’ont pas encore eu l’occasion de lire ce romancier rare, sans concession, styliste incomparable.
Deux parutions : Morphine Monojet aux éditions du Rocher, et le mois prochain, Cargo Sobre, chez Vagabonde.
Alors voilà notre chronique « infiltrée » : j’ai demandé à Thierry Marignac de la lire et d’intervenir quand ça lui chantait.
C’est exactement ce qu’il a fait, et voilà le résultat, que je trouve pour ma part franchement passionnant.
On n'est jamais si bien servi...
Guide de lecture : en noir, la chronique. En bleu, les interventions de l’auteur.
Ah oui, j’allais oublier la règle du jeu : entre le moment où j’ai terminé la chronique et celui où j’y ai ajouté les commentaires, le texte n’a pas bougé d’un iota.
Chronique infiltrée, certes, mais pas sous influence…
Aujourd'hui, avec Morphine Monojet, une fois de plus, l'homme déconcerte, et c'est bien...
Quand on écrit un nouveau roman, il faut toujours essayer d’aller plus loin que la fois précédente. C’est une remise en question perpétuelle. De même que dans À quai, je m’étais imposé la contrainte du huis-clos, dans Fasciste celle du discours politique, dans Morphine Monojet, je me suis imposé celle d’un roman dont l’action se déroule en trente heures. Il faut toujours un défi supplémentaire, sous peine de s’ennuyer, donc d’ennuyer le lecteur, et c’est le lecteur qui compte.
En 1988, au moment où le petit monde littéraire attend de lui un roman sur la dope, il publie Fasciste, et en prend plein la tête.
Aujourd'hui, 7 romans et plusieurs essais plus tard, il le publie, son roman sur la dope.
Esprit de contradiction, jeu de provocation ?
Non, car Morphine Monojet, malgré les apparences, n'est pas un roman sur la dope.
Pas seulement.
C'est une histoire d'obsession, c'est une course poursuite, une affaire d'addiction, une balade mortuaire.
Et une plongée vertigineuse dans le Paris de la toute fin des années 70.
Le plus surprenant, le plus beau paradoxe, c’est sans doute la fraîcheur qui se dégage d’un roman qui ne fait pas de cadeau, et qui se déroule dans un milieu en guerre perpétuelle.
On vivait tout ça comme si c'était normal. Si j'étais allé plus loin, je serais tombé dans le pathos, et ça n'était pas le but. L'intérêt, c'était d'écrire de l'intérieur, de montrer que pour ces gens-là, ce qu'ils vivaient était logique et spontané à cause d'une situation historique donnée. Tout était totalement absurde, du coup cela donne une vision de la vie très expressionniste, le grotesque comme un des beaux-arts. C'était notre parti-pris, sans qu'on en comprenne forcément toutes les implications.
Une situation de guerre
J’avais évoqué le monde de la drogue en observateur extérieur dans Fuyards ou Renegade Boxing Club, et c’est dans les nouvelles du Pays où la mort est moins chère que j’ai trouvé la façon satirique d’en parler sans tomber dans la tragédie. Au sortir de cet abîme de faiblesse qu’est la toxicomanie, l’essentiel c’était de réagir. D’où Fasciste, mon premier roman. J'ai voulu montrer l'esprit de l’époque : on était revenu de tout alors qu'on ne connaissait rien, no future, ce qui donnait cette forme d'esprit un peu humour noir. Je voulais aussi parler de cette période qui a laissé des souvenirs pénibles et douloureux, mais sans pathos, encore une fois. Et je ne pouvais le faire qu'en rigolant. Des petits bourgeois en voie de déclassement qui s'encanaillaient, et qui faisaient les blagues les plus cyniques possible pour justifier cette absurdité qui consistait à se mettre en situation de guerre. Car entre la délinquance, les braquages, les arnaques et les overdoses, on était en guerre quand on faisait partie de ce monde-là. Totalement absurde si tu considères la France de 1979, et ces gens qui venaient d'un milieu protégé. Pour parler de ça, il fallait une certaine ironie.
Nous avons tout oublié…
Le punk, c’était « no future » mais « no past » aussi. Avec des camarades, on avait écrit un manifeste qui commençait par "Nous avons tout oublié..." Finalement, ce qui est oublié maintenant, passé dans la réécriture de l'histoire, c'est que chacun essayait de retrouver des racines, mais il y avait le grand blanc de la IIe Guerre mondiale. On s'identifiait plus aux années 20 qu'à quoi que ce soit d'autre. Le punk était très inspiré par dada, à travers les situationnistes, et on était beaucoup plus dans cette idéologie-là que dans ce qui s'était passé dans les années soixante, à quoi on était complètement opposé. L'arrivée des drogues dures a été la fin des illusions. J'ai exprimé tout ça quand j'ai écrit Morphine Monojet, spontanément, sans calculer.
Toi et ton manque
On était en bande, malgré tout. Toute l'idéologie était latente chez chacun. Individualiste, bien sûr, et c'était une revendication par rapport au pseudo-collectivisme de la génération précédente. Mais en même temps, chacun avait ses rapports avec l'idéologie générale, avec chacun ses déclinaisons. Il y avait une atmosphère qui faisait qu'on se comportait ainsi et qu'on parlait ainsi, et qu'on menait cette vie-là. En particulier la dope : tu sais très bien que tu es sous la règle commune de tous les dopés, tu reconnais chez les autres les mêmes signes que ceux que tu présentes. Mais d'un autre côté tu es dans une solitude extrême: c'est toi et ton manque.
C'est ce que m'avait dit Richard Stratton, qui avait passé 8 ans en taule aux Etats-Unis pour trafic de marijuana : "You're never alone, but you're lonely there." L'histoire du junkie, c'est un peu ça : tu n'es jamais seul, mais tu es dans une solitude extrême. On était là-dedans collectivement, chacun cherchait à gruger l'autre s'il en avait l'occasion. Certains moins que d'autres, qui essayaient de garder un peu d'honneur. Mais même eux, tombaient parfois dans la règle générale. La misère, ça donne une sorte de loi commune qui fait que tu sais où en est l'autre parce que tu en es au même point, ou que tu l'as été deux heures auparavant. Ce qui créait un sentiment de communauté illusoire.
En même temps, tout ça était d'une absurdité totale, on était dans le grotesque : donc forcément, il y a de vrais éclats de rire. On a passé de très bons moments, quand même. C'est là que tout le discours dramatisant sur la dope est vraiment naze. A cause des très bons moments. Parfois à partir de situations horribles, comme c'est le cas dans le roman avec l'histoire du détrousseur de cadavres sympathique. Que je n'ai pas inventée...
Les Trois mousquetaires de l'histoire, Fernand, Al et le fils perdu, sont en manque de tout.
Mes personnages sont inspirés de personnes réelles, bien entendu, mais il serait vain de chercher des « clés ». Dans un roman, toutes les clés sont fausses, parce qu’on réinvente tout pour construire un drame cohérent qui contienne, non pas la lettre, disparue comme l’époque qu’on évoque et inaccessible, mais l’esprit, qui lui, demeure chez les survivants. Dans ce sens, plus on s’éloigne de l’anecdote dans une mise en scène, plus on se rapproche du climat, de l’atmosphère traversée.
Le commencement de la fin ?
C’est dans le même esprit que j’ai choisi de placer deux de mes personnages, Al et le fils perdu, dans la perspective des holocaustes du XXe siècle. Au-delà de l’anecdote inspirée par des circonstances réelles, des amis réels de ma vie réelle, ce choix correspond à l’idée de faire de la description d’un microcosme agité par de micro-évènements quelque chose de plus large, qui la rende significative. L’époque où se situe le roman, c’est en réalité la fin de l’après-guerre. Ou peut-être « le commencement de la fin », comme disait Churchill. Le glacis de la Guerre Froide était encore d’actualité, conséquence directe de la Seconde Guerre Mondiale, qui avait déjà des allures d’antiquité dans la brocante. La ville avait encore certaines caractéristiques dues à l’Histoire. Et à travers quelques décennies, notre errance portait encore les marques du « passé maudit de l’Europe ». Mes personnages, juif et arménien, portent les stigmates, à leur corps défendant, des hécatombes des deux guerres mondiales successives qui avaient ravagé le continent et continuaient leur travail de sape sur nos inconscients, transmis, à leur insu sans doute, par les générations précédentes, traumatisées.
Cette expression, « le fils perdu », évoque la question d’une filiation brisée, et d’une absence du père comme mythe fondateur. Cette « absence d’une présence intensément désirée » pour citer Mallarmé au sujet des anarchistes du procès des Trente, était pour nous « fondatrice » de la dérive où nous voguions, avec des déclinaisons variées. Chez mon personnage, elle est tout particulièrement tragique, mais c’est le cas de tous les personnages en question, d’où le sous-titre du roman « Les fils perdus ».
En manque de dope, et de fric.
"Les blancs-becs étaient en mission de survie. Ravitaillement de base. Déjà mal aux reins et les jambes lourdes, bientôt les crampes."
Le reste n'a plus d'importance : il faut trouver, coûte que coûte.
Ce jour-là, le salut va leur arriver en la personne de Jackie, belle et jeune orientale haut perchée, fille de diplomate, qui les entraîne chez elle, dans une maison de la rue David d'Angers, mobilier grand bourgeois, fauteuils profonds, hifi de luxe.
Jackie ? Elle est à la fois accessible et intouchable. Accessible, un cœur de fille comme on n’en fait plus, tendre et sensible au drame des fils perdus, parce qu’elle aime les hommes, désire leur salut et les voit en perdition. Intouchable, parce qu’elle vient d’une culture de grande bourgeoise qui retournera tôt ou tard à son milieu d’origine, quels que soient ses conflits d’identité, dus à son métissage anglo-arabe.
Et puis, au sous-sol, une certaine forme de Graal, qui trône au milieu de la collection du papa passionné par la Seconde guerre mondiale.
Une trousse de soldat anglais.
Morphine Monojet... "Une seringue à coup unique, dose de cheval pour le soldat blessé, mutilé, agonisant."
Graal mortel, pour chevalier décadent.
Une promesse de shoot unique, inoubliable, fatal, ou pas...
Al ne résiste pas : il prend le Graal sous son bras, et s'éclipse avec.
Et là, tout part en vrille, et le roman tourne à la course poursuite dans un Paris où on peut encore se perdre dans les ruelles entre Belleville et République, et aussi se faire braquer à coups de savon dans une chaussette...
Ces milieux-là reflètent la société dans son ensemble : c'est une reproduction de la société telle qu'elle est, mais en plus misérable. Tous les rapports hiérarchiques sont reproduits exactement comme dans la société en général. Aujourd'hui, il y a ceux qui traînent à la Goutte d'or, tous des rebeus ou des blacks; et puis il y a les « people » qui se font choper en train de sniffer de la coke. Et ces gens-là ne se mélangent pas. A l'époque dont parle Morphine Monojet, on se mélangeait systématiquement. On se connaissait, on traînait ensemble sans penser à autre chose. Ce n'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, les deux mondes ne se touchent plus jamais. Il y a maintenant des barrières ethno-raciales auxquelles on ne pensait même pas à la fin des années 70. A l'époque, on avait beau être petits bourgeois d'origine, on faisait partie du peuple.
Une ville à vendre
Parmi le peuple, on trouvait des gens qui avaient lu Céline, ou qui parlaient un français que plus personne ne parle. Paris était encore une ville populaire. A partir des années 80, tout a changé : Chirac a été élu maire de Paris en 1977... Ça a provoqué une forme d'uniformisation : on n'est plus dans une ville à vivre, mais dans une ville à vendre. Le tournant pris par la ville dans les années 1970 - et c'est un phénomène international - est une phase de la guerre des élites contre leurs peuples particulièrement frappante. En lieu et place d’endroits centralisés, on a délocalisé, et expédié des populations un peu trop éduquées, un peu trop susceptibles d’insurrection, le plus loin possible de leur histoire, dans des lieux anonymes, la « banlieue ». Dans le même temps, on vendait la ville sur le marché international, ses traits folkloriques devenant un objet de commerce, notamment pour le tourisme de masse. La population autochtone - et à Paris, elle comptait Dieu sait combien d’étrangers - devait être expulsée pour pouvoir mener à bien cette opération, ce tour de passe-passe, qui comportait bien des volets de spéculation immobilière. Paris, qui est ma ville, où je suis né, où j’ai grandi, où j’ai appris à vivre, comme on dit mon premier amour, j’en ai été chassé par ces manœuvres post-modernes. Chirac fut le premier élu, et fit de cette mairie sa rampe de lancement vers le pouvoir. Les maires de gauche qui lui ont succédé ont poursuivi en pire cette politique de mort, sous les prétextes de la politcorrectitude en vigueur, vente de la ville sur le spectacle marchand international par « internationalisme ». Aimer encore Paris ?… Je suis trop vieux pour ça. La « ville aux cent villages » de ma jeunesse n’est plus qu’un souvenir, américanisée (la vérité de la mondialisation) selon le plus petit commun dénominateur.
"La nuit, tout est mirifique."
Je citerai mes sources : il s’agit d’une phrase de Raymond Chandler, dans sa correspondance, qui déconseillait d’écrire la nuit. La toxicomanie se nourrit de l’aspiration à un état supérieur de conscience, à une extase où les tensions sont résolues. Tant qu’on a de la poudre, on peut y croire. En manque, on retombe dans la mesquinerie la plus sordide et la vie du toxico est déchirée entre ces deux extrêmes.
En arrière-plan, l'obsession du Morphine Monojet, là, dans le creux de la poche ou de la main, promesse d'extase ou de mort...
Et nous, nous profitons de cette fuite en avant pour (re)découvrir sous la plume de l'auteur le Paris de l'époque, sa topographie, ses codes disparus, les sons de ce temps-là (des Sex Pistols aux Stooges), les personnages de l'underground parisien - qui, eux, n'ont finalement pas tant changé...
Au passage, il nous offre des scènes à la limite du burlesque…
Oui, le personnage du « Gros taré » est carrément burlesque. C'était un personnage qu'on surnommait "gros débile", dans la vraie vie. A cette époque-là, c'était une sorte de héros du rock n'roll, très marrant. Il frimait beaucoup et vivait quantité d'aventures burlesques. Il était régulièrement recherché par les Hells de Malakoff ou de la rue de Lappe, ils se faisaient leurs petits westerns, et il s'en sortait toujours. En 1984, d'ailleurs, il était encore là ! C'était le genre de personnage qu'on rencontrait dans ces milieux-là, une figure picaresque, qui avait une légende. Un jour, il est venu à Zoulou, un éphémère magazine où j'ai travaillé, lancé par Actuel au moment où ils voulaient faire concurrence à Métal Hurlant. Il a débarqué et il y avait là une autre légende, ex-journaliste à Libération, bourré de talent mais vraiment trop camé, qui avait fait 5 ans de taule pour braquage - il avait encore ses tatouages de taulard. Il faisait deux mètres. Il regarde Gros débile et lui fait "Ça existe encore, ça?". Et là l'autre sort un 357 Magnum... Mauvais caractère, quoi. Il m'est revenu spontanément à l'esprit, car c'était ce genre de type qui braquait à l'entrée des concerts et qui faisait en même temps le service d'ordre.
Dans ce sens-là, c'était une époque très baroque.
J'ai voulu montrer l'esprit qu'on avait : on était revenu de tout alors qu'on ne connaissait rien, no future, ce qui donnait cette forme d'esprit un peu humour noir à la Philip Marlowe, un peu Bazooka. Je voulais aussi parler de cette époque qui a laissé des souvenirs pénibles et douloureux, mais sans pathos. Et je ne pouvais le faire qu'en rigolant. Des petits bourgeois en voie de déclassement qui s'encanaillaient, et qui faisaient les blagues les plus cyniques possible pour justifier cette absurdité qui consistait à se mettre en situation de guerre. Car entre la délinquance, les braquages, les arnaques et les overdoses, on était en guerre quand on faisait partie de ce monde-là. Totalement absurde si tu considères la France de 1979, et ces gens qui venaient d'un milieu protégé. Donc pour parler de ça, il fallait une certaine ironie.
Quand j’ai eu fini d’écrire, j’étais triste…
Aujourd'hui, je traîne dans les mêmes rues qu'à l'époque, et ce n'est plus la même ville. J'ai pris beaucoup de plaisir à décrire la ville de cette époque-là, celle que j'avais aimée. Et quand j'ai eu fini d’écrire, j'étais triste. C'est mon deuxième bouquin sur Paris; le premier était Fasciste. Ça n'est pas bien passé... alors après j'ai arrêté d'écrire sur Paris, et sur la France en général. J'ai écrit sur l'Ukraine, sur les Etats-Unis, la Russie. Il a fallu Morphine Monojet pour que je retourne à Paris, alors que je suis parisien jusqu'aux entrailles. C'est ma culture, c'est ce que j'ai toujours apporté ailleurs, que ce soit en Russie, aux Etats-Unis ou en Ukraine : si j'étais admis, c'est que je faisais le Parisien ! C'était ça qu'on aimait, l'identité. Et même il y a trois mois, quand je suis allé à Ekaterinenburg, dans l'Oural, c'était la même chose, les gens là-bas me considéraient comme le représentant d'une culture dont ils se sentaient proches. Même chose dans les bas-fonds des Etats-Unis.
Une volonté de rester élégant
Et bien m'en a pris, parce que si je m'étais laissé pousser les dreadlocks, si j'avais mis un survêtement rouge, on m'aurait pris pour un balletringue de plus ! Je ne cherchais pas à m'assimiler. Cet esprit-là, c'est celui qu'on avait à l'époque de Morphine Monojet.
Contrairement à beaucoup, je n'ai pas fait la girouette, je n'ai pas beaucoup changé... Ça a peut-être maintenant un côté dandy qui n'était pas forcément le mien au départ. Mais c'est vrai, c'est ce que me dit l'auteur belge Christopher Gérard, qui est un vrai dandy, lui, un qui se commande des costumes à Savile Row. Dans nos comptes à régler avec la génération 68, il y avait le fait qu'ils avaient fait du reniement leur profession de foi. Nous, en voyant ça, on a éprouvé un dégoût très violent et ceux qui ont survécu avaient à cœur de ne pas faire ça, de rester ce qu'ils avaient été dès le départ. Une volonté de rester élégant, d'une certaine manière, de ne pas se laisser dicter quoi que ce soit par les temps. Pas comme cette génération 68, parmi laquelle beaucoup ont voulu se faire passer pour des héros du peuple et nous donner des leçons, et ont retourné leur veste radicalement.
Cette course poursuite-là n'est surtout pas un prétexte à la nostalgie, au culte rétro et à l'insupportable "vintage".
La facilité était de recourir à l’effet rétro, comme ces livres ou films sur le passé, où l’on reconstitue un décor artificiel, en insistant sur les détails pour l’effet nostalgique. J’aurais eu honte de faire ça. J’ai tenté de limiter ces effets au maximum, pour donner au roman sa chance d’être autre chose.
Elle n'est surtout pas un témoignage moralisateur.
C'est un morceau de vraie littérature, avec de la douleur et de la colère dedans, le deuil aussi de ceux qui n'ont pas survécu.
Le deuil de ce qu'ont perdu les garçons et les filles que la dope a grillés, en tuant chez eux le souffle qui fait vivre, qui pousse à continuer, qui donne naissance à la beauté, même si elle est brutale...
Et puis, à nous qui avons oublié la poésie, reléguée dans quelques rares librairies à un rayon biscornu, tout au fond, dans l'ombre, il nous la donne, comme ça, d'emblée, généreusement, sans crier gare.
De même que la vérité journalistique-factuelle est dans les interstices des propagandes, bestiales par nature, la poésie est dans les anfractuosités de la fiction admise. Le roman, un art à part entière et décrié par le post-structuralisme qui nous tient lieu de religion ces temps-ci, s’il sort du commérage débilitant à la Gala et de l’utilitarisme abrutissant de la « littérature engagée», tous deux petits commerces, peut être une source de poésie, à condition de s’y consacrer entièrement, fanatiquement, sans la moindre concession post-moderne, sans la moindre concession torchon à scandale, comme disait ma grand-mère. Il convient pour cela de retourner à l’art primitif du conteur, qui savait faire rire, rêver, réfléchir, sans autre but final que de faire passer un bon moment, au-delà des contingences.
Pas besoin de photos : Marignac a tous les mots pour éveiller les souvenirs de ceux qui ont connu ce Paris-là, et enfiévrer l'imagination de ceux qui ne l'ont pas vu.
Quel que soit son sujet, on reconnaît immédiatement le "style Marignac" : un vocabulaire qui puise dans tous les registres, y compris les argots d'un autre temps, un souffle poétique qui se passe de commentaires...
Phrases tantôt hors d'haleine, courtes, sans verbe, tantôt tortueuses, labyrinthiques, jeux de pistes débouchant sur de la pure beauté.
Chez lui, le suspense est au bout de la phrase...
Dialogues au rasoir, de cynisme en désespoir.
Voilà un texte qui secoue - "Ne me secouez pas, je suis plein de larmes", écrivait Henri Calet...-, un roman qui néglige de brosser ses lecteurs dans le sens du poil, mais qui n’oublie pas de prendre la distance, à renfort d’humour sec, froid, salutaire.
Avec une dernière phrase qui donne envie de retenir l’auteur par la manche, histoire qu’il ne nous laisse pas comme ça, en plan…
Le personnage qui prononce cette réplique doit se défendre tout seul parce que personne ne le sauvera. Les autres ont l’illusion d’être protégés pour toujours par leurs familles, et ça les voue, par un effet pervers, à une autodestruction sans frein. Pas lui, il vit sans garde-fous.
|
_________________
« Il vaut mieux cinq mille lecteurs qui ne vous oublieront plus jamais à des centaines de milliers qui vous auront consommé comme une denrée périssable. » Jérôme Leroy |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
norbert
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 48
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 12137
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le: Jeu Fév 04, 2016 7:00 am Sujet du message: Posté le: Jeu Fév 04, 2016 7:00 am Sujet du message: |
 |
|
>> La chronique de Claude Le Nocher sur Action-Suspense :
| Citation: |
[...]
La France des junkies d'avant 1980 reste marijuana, cocaïne et héroïne.
Les produits de synthèse, tout aussi nocifs, débarquent à peine chez nous.
Chacun son “trip” chez ces condisciples en autodestruction :
“Si la poudre était pour tous une déchéance, elle était pour Al une mise en scène d'autiste aggravant son isolement, pour le fils perdu un soulagement intermittent créateur de nouveaux cauchemars, pour Fernand une fuite en avant vers les abysses de l'origine. Chacun connaissait les symptômes des deux autres par cœur. Et les enfers intimes des uns et des autres n'accusaient au fond, dans la détresse secrète qui les soudait, que des différences de détails.”
Les héros de ce récit ne sont pas incultes, ils sont conscients de leur dépendance.
Ça fait partie de leur choix de vie, inspirée du “no future” des punks.
Ce ne sont pas de pitoyables larves, même s'ils en prennent le chemin.
Ils sont en mesure de maîtriser, encore un peu, leurs faits et gestes.
D'essayer de réparer la connerie commise par un des leurs.
Belle occasion de présenter de singuliers personnages :
“Puis le fils perdu reconnut le rocker étalé au centre du divan, qu'on appelait Gros Taré dans le milieu des voyous rock'n'roll… Il traînait derrière lui une légende de poignard et de manche de pioche, d'agressions de rues avec d'autres bandes défrayant la chronique de l'époque – les Hell's de Malakoff et ceux de la rue de Lappe… Gros Taré était le fils d'un commissaire de police désespéré par sa progéniture, qu'il avait renoncé avec le temps à sauver des foudres de la loi.”
Il y a l'intrigue, avec sa part de suspense dans les tribulations de ces camés, et la manière de raconter l'histoire.
Si l'auteur emprunte peut-être des souvenirs personnels, ce n'est pas avec une nostalgie d'Ancien Combattant de la punk-attitude.
Il témoigne d'une époque, à l'aide d'une écriture vive et soignée :
“Jackie, instantanément relancée sur des nerfs en vrille, plus la moindre trace de l'égérie lasse de la veille les comblant d'une générosité maternelle avant de sombrer elle-même dans les affres, faillit lui sauter au visage...”
Nul besoin de gonfler le nombre de pages, quand l'aventure trouve son rythme et sa tonalité propre en 150 pages.
Une précision claire et nette guide la narration.
C'est un des atouts qu'on apprécie chez Thierry Marignac.
|
_________________
« Il vaut mieux cinq mille lecteurs qui ne vous oublieront plus jamais à des centaines de milliers qui vous auront consommé comme une denrée périssable. » Jérôme Leroy |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
holden
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 58
Inscrit le: 02 Avr 2007
Messages: 3669
Localisation: restons pragmatique

|
 Posté le: Jeu Fév 04, 2016 11:08 am Sujet du message: Posté le: Jeu Fév 04, 2016 11:08 am Sujet du message: |
 |
|
magnifique
_________________
lisez ce vous voulez . . .
http://unwalkers.com |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
norbert
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 48
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 12137
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le: Mar Fév 09, 2016 7:29 am Sujet du message: Posté le: Mar Fév 09, 2016 7:29 am Sujet du message: |
 |
|
>> La chronique de Jacques-Olivier Bosco [ alias JOB ] sur Nyctalopes :
| Citation: |
Légende urbaine !
Déguster, je m’attendais à déguster en attaquant le roman de Thierry Marignac et je ne fus pas déçu.
Dès la première phrase, l’écrivain français envoie l’encre ; « Trois mousquetaires en imper, cinq heures d’hiver, dans le jour de ces années-là, qui tombait comme un suaire. »
Toute l’histoire du livre, une jeunesse d’hiver, la mort qui rôde, mais toujours les impers, la fleur à la boutonnière.
Trois mousquetaires donc, trois petits bourgeois, fils (« perdus ») de « bonne » famille, mais aussi d’une génération dont les proches parents ont connu guerre, exode ou massacre, nous sommes en 1979, dix ans après les petits minets du Drugstore et une décennie avant la chute du mur de Berlin, les tubes de Madonna et la rage de Noir Désir.
Eux c’est l’époque de « Crache ton venin » et de « London calling », même si ces jeunes-là écoutent les Stooges d’Iggy Pop, et se représentent la fin de Sid Vicious de manière philosophique, reflets de leur « obsession punk » adolescente.
On est dans le ventre de Paris, des bouges de Belleville, aux rues de la Bastille, on va à « Répu », on traine devant le Palace qui vient d’ouvrir, la boite proche du Faubourg Montmartre, chez Chartier juste en face, et au salon de thé du dernier étage des Galeries Lafayette où les grand-mères de nos trois garnements devaient les emmener goûter le mercredi.
Ils ont maintenant dans les vingt ans et vivent la nuit, croisent des Tunisiens, des noirs, des blancs-becs et des braqueurs à la matraque, pas de ségrégation raciale ni même sociale, une langue commune, un objectif ; la dope.
Le brown sugar a supplanté la Blanche depuis quelques années, il déferle à bas-prix sur l’Europe, ce sont les années « Christiane F » (1976), la mort par overdose de Janis Joplin (1980) ou du batteur des Taxi-girl (1981).
Qui traînaient sa jeunesse la nuit dans l’eau marron (teintée d’une pointe de citron) de ces années-là, ne découvraient pas le jazz ou les rythmes yéyé, mais la chaude extase et le transport d’un shoot dans le sang.
Malheureusement, que l’on soit black, banlieusard, ou de Neuilly, l’héroïne, on y tombe accro, mais pour autant, il ne s’agit pas d’un roman sur la déchéance, les remords, la honte, ni même sur la joie de la défonce.
C’est un roman sur la recherche d’un combat, à en crever.
Marignac parle d’une jeunesse en ces années, trois origines différentes, arménienne, française, juive, trois caractères, mais trois maux de vivre générationnels dont j’ai parlé plus haut, traduits à une sorte de dandysme décadent, de romantisme bourgeois, et même d’un spleen que Baudelaire n’aurait pas renié.
Nos parents sont riches, mais les ponts sont coupés, il n’y a pas d’études à suivre, de travail à trouver, juste des pavés à fouler.
Dans la nuit.
Des choses à voir, à vivre, au coin de la rue, pourtant.
On se drogue, on se shoote, on veut l’extase et la chaleur de l’insouciance mais aussi l’aventure, le risque et « l’omniprésence du danger », non seulement à travers les rencontres nocturnes, les échanges lors desquels il faut ferrailler, tels des mousquetaires et chacun à leur caractère, mais aussi lors de la prise de drogue où l’on frôle l’exploit de vivre à chaque injection.
Il y a ce rapport à la mort, que tout toxico connaît (que cela soit d’alcool, de clopes ou de médocs), ce besoin intrinsèque de se détruire, une sorte de punition de vivre, de suicide latent, alors que tant d’autres sont morts, en combattant, en fuyant, en essayant de sauver leur proches.
Tant d’autres qui avaient un but, même désespéré.
Personnages nihilistes à leur niveau – on retrouve le nom de Loutrel (déjà cité dans une nouvelle du même auteur), le fameux Pierrot le fou qui, plein de haine, traversa la guerre et les balles, avant de s’en planter une, comme un grand, dans l’aine.
On va suivre Al qui a piqué (non pas du nez, mais) chez une frangine des beaux quartiers une seringue emplie de morphine datant de la guerre.
Dès lors, notre héros n’aura qu’une envie, s’envoyer la totale !
Sachant la poudre de cette seringue peut-être empoisonnée par le temps, ou bien, d’une pureté cadavérique.
Le shoot ultime !
La vague de Point break (le film) !
« Le coup de pied de mule d’une dose de légionnaire. »
La vie est un jeu, que l’on gagne ou que l‘on perde n’a guère d’importance, l’intérêt est d’être de la partie.
Alors, il ne faudrait pas croire par ces mots que le récit est sinistre et sombre, bien on contraire, il s’agit d’un roman d’aventure, souvent d’un humour fin, avec des sentiments, de l’amour et de l’honneur, car contrairement à l’idée reçue, tous les drogués n’auraient pas tué père et mère pour un fix, certains s’accrochaient à leur honneur comme un pied de nez à ce putain de manque, tant que faire se peut, il faut l’avouer, mais la volonté y était, et une belle amitié entre nos trois dandies en ressort.
Car, alors qu’il n’y avait pas moyen de juger l’autre sur ses actes, la fourberie faisant partie du jeu, il fallait l’aimer pour ce qu’il était, son esprit (son humour fin, pour simplifier), et les limites qu’il s’était imposé, même si on les savait percées (tous comme ses veines) de longue date.
Les amis de Al, chacun avec leurs soucis et leurs besoins, vont quand même s’unir pour le retrouver et le sauver, ou le punir, cela dépendra du point de vue.
Thierry Marignac nous offre une belle leçon d’histoire, une saga de rue parisienne peuplée de rockers lourdauds, d’Antillais en manque, de beauté métis et de gentilshommes – ou face au flegme et à la brutalité britannique, s’impose la flemme et le cynisme français – mais aussi une réflexion sur ces sentiments qui brûlent nos jeunes années, propres à chacun, mais il y a trois, sinon plus, de personnages dans cette histoire et donc autant de ces sentiments.
Le tout avec une beauté dans le style (on reconnaît parfois l’école russe – le rire poitrinaire -), un rythme mené, un don du conte extraordinaire (la scène, et celles qui suivent, où Al rencontre Phil est splendide), d’ailleurs, ce roman est parsemé de plusieurs de ces moments de bravoure (un mot qui plairait à Al).
Pour conclure, au delà du rythme et du suspense du récit, de l’empathie à la tendresse philosophique qui nous lie à ses personnages, Thierry Marignac manie la plume comme un fleuret, avec virtuosité, classe et raffinement, et même, souvent, avec panache.
C’est un plaisir de le lire, de le suivre, tous comme nous suivons ces trois mousquetaires, qui eux, affrontent la vie à la pointe de leur aiguille.
Le roman peut paraître court, mais, tout comme Dumas pour ses mousquetaires, ces personnages, ou ces années parisiennes (vécues par l’auteur) pourraient revenir en d’autres tomes..
N’est-ce pas ?
|
_________________
« Il vaut mieux cinq mille lecteurs qui ne vous oublieront plus jamais à des centaines de milliers qui vous auront consommé comme une denrée périssable. » Jérôme Leroy |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
norbert
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 48
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 12137
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le: Dim Fév 14, 2016 9:23 pm Sujet du message: Posté le: Dim Fév 14, 2016 9:23 pm Sujet du message: |
 |
|
>> La chronique de Pierric Guittaut sur son blog :
| Citation: |
A l’instar de son Fasciste inaugural, ce nouvel opus de Thierry Marignac se constitue en témoin d’un espace-temps englouti par plusieurs décennies de mondialisation féroce.
Sauf qu’ici c’est la décennie antérieure, celle des années soixante-dix, qui s’achève sur la toile de fond du Paris interlope de la dope, hanté par la lie humaine fantomatique qui y décante.
En dépit de son sujet, Morphine Monojet est un livre lumineux qui se lit d’une traite.
Non pas à cause de cette histoire prétexte, cette course poursuite autour d’une ampoule réglementaire de morphine pure dérobée à un collectionneur de militaria de la seconde guerre mondiale, et qu’un des protagonistes suicidaire planifie de s’injecter en grandes pompes lors d’une apothéose nihiliste, non.
On dévore cette histoire pour tout ce qu’il y a autour, tout ce qu’il y a dedans.
Pour la plume et le style, pour l’élégance désespérée, pour la façon dont l’auteur nous parle des femmes, pour la subtilité des personnages, pour l’humour froid et la franchise, pour l’absence de romantisme en toc qui plombe les repentis qui voudraient nous faire croire qu’ils ont vécu malgré tout quelque chose de grand et de terrible dans leur malédiction.
On ressort de la lecture de Morphine Monojet sans sympathie ni pitié pour son trio de pieds-nickelés de la came, et c’est à ça que se mesure le talent de l’auteur, à ce détachement et à la vision du monde que celui-ci esquisse.
Une vision aristocratique où le principal échec des personnages les plus « accros » du roman ne réside pas dans leur déclin physique ou leur degré d’addiction, mais dans leur déshonneur.
Ce n’est pas anodin si plusieurs allusions à la généalogie et à l’héritage viennent parsemer ce court roman.
Car au-delà du récit picaresque planté dans un Paris interlope à une époque charnière, Morphine Monojet est surtout la chronique d’une prise de conscience d’une certaine jeunesse de ses manquements irrémédiables face à l’antique devoir d’honneur d’une lignée et d’un héritage.
Une lutte centrale, tellurique, au coeur du personnage de Fernand qui cherche avant tout, par-delà la morale de l’hygiénisme, à rester digne.
Parce que sans dignité, il n’y a plus d’être humain, simplement des marionnettes pathétiques ou tragiques qui se trémoussent ou se contorsionnent dans les affres écoeurantes d’une fin de race et d’une fin de civilisation.
C’est l’ombre du Feu follet de Drieu La Rochelle qui plane sur ce Morphine Monojet froid et cruel.
Si la littérature est bien ce que vous cherchez dans un roman, un crochet du gauche par ce dernier Marignac en date sera votre douce punition.
|
_________________
« Il vaut mieux cinq mille lecteurs qui ne vous oublieront plus jamais à des centaines de milliers qui vous auront consommé comme une denrée périssable. » Jérôme Leroy |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
norbert
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 48
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 12137
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le: Ven Fév 26, 2016 6:10 am Sujet du message: Posté le: Ven Fév 26, 2016 6:10 am Sujet du message: |
 |
|
>> La chronique de Laurent Greusard sur K-libre :
| Citation: |
Délicieusement vides
Le terme est étrange dans sa dénomination même car la morphine monojet n'est pas une drogue particulière, mais un ustensile spécial qui eut son heure de gloire durant la Seconde Guerre mondiale.
Il s'agissait d'une petite seringue de morphine, destinée aux soldats en mission, censée leur donner un coup de fouet en cas de blessure.
Lorsque Al en trouve une, il croit avoir atteint le Saint Graal des drogués.
Nous sommes à l'aube des années 198O dans le Paris punk qui vit encore à l'ombre des vieilles rues, quand Daniel Darc commence à donner de la voix et danse sur les rues pavées de Montmartre et, bien avant la mondialisation galopante, quand la Capitale est encore une ville française.
On retrouve chez Thierry Marignac ce qui fait le charme des textes de Marc Villard ou, en version plus sage, l'ombre portée des romans de William S. Burroughs.
Des "petits" drogués survivent dans la ville, essaient de concilier leurs petites magouilles, les diverses arnaques, tous les moyens de s'injecter dans les veines de quoi oublier le gouvernement grisâtre de Giscard et l'impression que la tradition lourde de la France profonde va encore durer des siècles.
Centré autour de trois personnages, Al et ses deux compagnons de débauche, Morphine Monojet déploie une intrigue minimaliste : une première partie évoque le quotidien de nos trois Pieds nickelés, avec un regard sympathique, qui ne juge pas.
Puis le roman accélère lorsque les deux acolytes tentent de retrouver Al, car ils ont peur que ce dernier n'utilise la fameuse seringue Morphine Monojet pour un feu d'artifice, un départ en beauté, une overdose grâce à la Drogue Ultime.
Il y a une sorte d'urgence et en même temps, par son style, Thierry Marignac ne sombre pas dans le pathos et c'est ainsi que les scènes oscillent entre tendresse et (presque un côté) burlesque.
Le texte est court car le sujet ne nécessitait pas une grande ampleur (d'ailleurs, Marc Villard lui-même dans ses textes autour de la drogue s'arrête souvent à la densité de la nouvelle et William S. Burroughs augmentait la pagination des siens avec ses cut-up plus que par la densité de l'intrigue) et s'adapte parfaitement à cette évocation fine, tendre et attachante d'un monde disparu, d'une certaine nostalgie d'un passé plus calme (même s'il y a quelques scènes plus dures), de ce moment où la drogue et son fléau restaient encore un peu artisanaux.
|
_________________
« Il vaut mieux cinq mille lecteurs qui ne vous oublieront plus jamais à des centaines de milliers qui vous auront consommé comme une denrée périssable. » Jérôme Leroy |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
norbert
Serial killer : Hannibal Lecter
Age: 48
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 12137
Localisation: Rhône-Alpes

|
 Posté le: Jeu Juin 16, 2016 10:58 am Sujet du message: Posté le: Jeu Juin 16, 2016 10:58 am Sujet du message: |
 |
|
>> Un article de l'auteur Jérôme Leroy dans Valeurs actuelles :
| Citation: |
Marignac ou l’errance romanesque
Détaché.
Portrait, à l’occasion de la parution de deux livres, d’un écrivain qui conjugue style et colère froide.
Thierry Marignac est un caractère ombrageux.
On l’a vu ces quatre dernières décennies dans de multiples points du globe refuser de sourire et préférer des retraits sur des Aventin paradoxaux qui n’ont rien fait pour améliorer sa mauvaise réputation dans le milieu littéraire : Moscou, Kiev, New York, Londres, Belfast, Bruxelles, Paris parfois…
Aujourd’hui, pour le trouver, il faut aller au Havre, alors que deux parutions de cet écrivain rare, un roman nerveux, Morphine Monojet, et un récit de voyage méditatif, Cargo sobre, sont sur les tables des libraires.
Il est toujours plaisant de rencontrer celui qui donne une telle mauvaise conscience à divers apparatchiks des lettres, notamment dans le milieu du polar, depuis son premier roman, Fasciste, qui fit un peu parler de lui, en mal évidemment puisqu’il racontait à la première personne l’itinéraire d’un jeune Français nationaliste ivre de Guinness.
Près de trente ans après, Marignac en parle avant tout comme d’une expérience sensorielle, là où de mauvais esprits voulurent voir un livre politique :
« Je suis passé en Irlande du Nord en 1986 pour voir la guerre, à Belfast. Quelques mois les doigts dans la prise. Je me souviens d’être revenu à Dublin, ensuite, et tout à coup détendu, d’avoir ressenti, rétrospectivement, toute la tension de l’Ulster qui refluait dans mes veines, afflux d’endorphines. »
Pour comprendre Marignac, sans doute faut-il remonter à son expérience douloureuse des paradis artificiels, racontée dans Morphine Monojet, vrai-faux roman noir dans le Paris de 1979, et son illusion d’y trouver l’or du temps comme aurait dit Breton, l’une des lectures de celui qui n’admet pour compagnons d’errance que les surréalistes ou les poètes russes contemporains dont il est un magnifique traducteur : « La traduction, c’est mon école à moi qui l’ai si peu fréquentée », avant d’ajouter : « Je ne peux savoir qui j’étais, à l’époque dont est inspiré Morphine, qu’à travers le roman, me transplanter dans le Paris de l’époque, les enjeux de l’époque, dans une fiction dont il serait vain de chercher les clés. Je les ai recréés dans un théâtre de marionnettes qui ne s’est jamais produit tel qu’il est présenté. »
C’est pour cela que Cargo sobre, qui complète Morphine Monojet comme un codicille, a été écrit à la façon dont les marins, précisément, font le point.
Lors de cette traversée, effectuée en 2013 entre Fos-sur-Mer et Port Elizabeth à New York, Marignac égrène des souvenirs et fait l’expérience inédite d’un régime sec puisque toute boisson alcoolisée est proscrite à bord.
Mais qu’importe : « C’est si souvent carême dans cette vie où l’on bivouaque sur des eaux instables, au large de ports encombrés, en nourrissant l’attente d’espoir. »
Là encore, c’est l’occasion de percevoir autrement le monde et le temps, le ciel et la mer, entre les barbecues organisés par des marins philippins, les conversations avec les officiers roumains et les passagers occasionnels, un autre écrivain dont on ne saura pas le nom et un aiguilleur du ciel zurichois.
Un microcosme de la mondialisation qui, étrangement, fait échapper Marignac à ce monde qu’il n’aime guère à cause de sa volonté de transparence inquisitrice.
À peine s’il confie, au passage, qu’il découvre à ce moment-là qu’il est un enfant illégitime et qu’il regrette de n’avoir même pas une photo de son père biologique.
On discerne dans Cargo sobre, comme épuré, ce qui fait la matière de ses précédents livres.
On citera Vint, le reportage halluciné en Ukraine quand l’auteur travaillait pour une ONG de prévention de la drogue, Renegade Boxing Club quand il fut entraîneur de boxe dans les quartiers noirs du New Jersey, ou l’expérience tout aussi réelle de Fuyards, liée à une autre de ses amitiés anciennes, Édouard Limonov : « En 2001, l’année où Limonov a été emprisonné, malgré des embrouilles avec le FSB, je suis retourné en Russie pour un an. »
Homme détaché et écrivain attachant, Marignac sait déjà que Le Havre ne sera qu’un moment dans sa vie à la Cendrars.
Il est affligé du mouvement comme d’autres le sont d’une maladie : « Ce n’est qu’une belle étape dans la dérive commencée il y a maintenant quarante et quelques années. »
Alors, bon vent, monsieur Marignac !
|
_________________
« Il vaut mieux cinq mille lecteurs qui ne vous oublieront plus jamais à des centaines de milliers qui vous auront consommé comme une denrée périssable. » Jérôme Leroy |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|